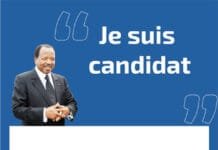L’Afrique, dit-on se porte mieux sur le plan économique.  C’est un fait. Mais l’Etat de droit, géré par la démocratie et la bonne gouvernance qui devrait accélérer cette croissance économique tarde à s’installer définitivement sur le continent. Si le Mali a repris espoir, le Niger tangue, tandis que la Centrafrique s’enfonce.
C’est un fait. Mais l’Etat de droit, géré par la démocratie et la bonne gouvernance qui devrait accélérer cette croissance économique tarde à s’installer définitivement sur le continent. Si le Mali a repris espoir, le Niger tangue, tandis que la Centrafrique s’enfonce.
Au Mali, la prestation de serment du nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, le 4 septembre dernier marque un nouveau départ, après « une longue nuit noire peuplée des pires cauchemars », comme il l’a déclaré dans son discours d’investiture. Ce mauvais film a commencé en mars 2012, quand une partie de l’armée a retourné les armes contre le pouvoir civil, contraignant à la démission, le présidentAmadou Toumani Touré. Ensuite, il a fallu que la France et d’autres pays africains, dont le Tchad, interviennent militairement pour éviter que le pays passe sous le contrôle de groupes « terroristes » et « islamistes radicaux ». Le pouvoir de transition conduit par Dioncounda Traoré, ancien président de l’Assemblée nationale a pour sa part créé les conditions pour que se déroulent au mieux des élections menées au pas de charge, qui ont donné la victoire à Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), sur un score pharaonique de près de 78% des suffrages.A présent qu’il est aux commandes, Monsieur Keita devra rapidement montrer qu’il est capable de mettre en œuvre la réconciliation nationale qu’il a lui-même fixée comme la priorité la plus pressante de son mandat de cinq ans.Les autres éléments de sa feuille de route sont : la réforme de l’armée, la reconstruction de l’appareil d’Etat et la lutte contre la corruption. Le président malien qui se fait appeler Kankelentigui (en bambara, « l’homme qui n’a qu’une parole ») réussira-t-il à mettreà flots un pays qui sort à peine de la plus grave crise qu’il ait connue?Il a déjà annoncé pour bientôt, la tenue« des assises nationales du Nord, discussions destinées à permettre le règlement définitif des rébellions récurrentes dans cette partie du pays depuis son indépendance ».Par chance, plus de 3,2 milliards d’euros ont été promis par la communauté internationale pour réaliser de nombreux projets de développement. Reste que la paix, préalable à l’essor de l’économie est menacée par une éventuelle résurgence de l’insécurité dans le nord du pays à la faveur du désengagement militaire annoncé de la France
Au Niger, un gouvernement d’union nationale divise durablement la classe politique.Officiellement, son avènement avait pour objectifs de contourner par l’union, les périls qui menacent la nation : incursions jihadistes et contagion du fléau BokoHaram, le groupe islamiste nigérian. Noble intention du président Mahamadou Issoufoudont le calcul électoraliste a été tout de suite éventé par son allié du moment, Hama Amadou, président de l’Assemblée nationale qui a soutenu le chef de l’Etat à l’élection présidentielle de mars 2011. Visiblement, tous les deux pensent aux élections de 2016, et chacun affûte ses armes. La conséquence de ces calculs est que le pays risque de devenir ingouvernable. La coalition des partis PNDS et ModenLumana tangue dangereusement. Des ministres de Lumana nommés au gouvernement sans l’accord de leur parti refusent de rendre leur tablier. C’est vers une recomposition politique que l’on court. Le Niger n’avait vraiment pas besoin de cette crise, dans un contexte d’insécurité régionale dans lequel les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers temps dans le pays. Les questions liées au développement économiques du Niger qui compte parmi les pays les plus pauvres du monde demeurent entières. Il faut espérer que Messieurs Issoufou et Hama, qui comptent parmi les leaders politiques nigériens les plus expérimentés vont savoir surmonter leur antagonisme, pour éviter à leur pays une instabilité institutionnelle, propre à compromettre ses chances de développement.
Comment aider la RCA à retrouver le chemin de la paix et à faire aboutir le processusde transition? Voilà une question lancinante sur laquelle la communauté internationale bute depuis plusieurs mois maintenant, alors que le pays s’enfonce dans l’insécurité généralisée. A cela s’ajoutent les violations des droits de l’homme et l’incapacité à contrôler l’ensemble du territoire. Leprésident de la transition, Michel Djotodia, vient de prendre une première mesure positive en décidant que les patrouilles à Bangui ne seraient désormais plus assurées par les éléments de la Séléka, la coalition qui l’a menée au pouvoir, mais par la police et la gendarmerie. Il n’a pas hésité à confier à Josué Binoua, un fidèle de l’ancien président François Bozizé, la responsabilité de cette opération délicate.Il reste la mise en place de la Mission de soutien à la Centrafrique Afrique (MISCA) et l’accélération de la montée en puissance ou l’augmentation des effectifs de la FOMAC, la Force multinationale de l’Afrique centrale dont les effectifs doivent atteindre le chiffre de deux mille voire plus.Mais elle ne s’attaque pas au noeud du problème : le désarmement et le cantonnement des rebelles. L’autre priorité pour les autorités est de démobiliser les barrages de la Séléka sur la route menant au Cameroun, afin de permettre aux agents des douanes de prélever les recettes fiscales. En tous les cas, on approche l’heure de vérité en Centrafrique. Ou le chaos perdure. Ou alors
lacommunauté internationale s’engage davantage. Le pays doit être mis sous tutelle africaine ou onusienne, en confiant à la Misca des prérogatives larges de sécurisation, surveillance des droits de l’homme, réforme des forces de sécurité et organisation d’une élection inclusive, crédible et transparente dans les dix-huit mois. C’est le seul moyen de sauver la RCA.
Richard Kemmogne