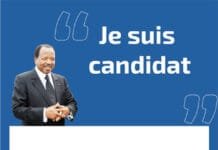L’éminent professeur philosophe Lazare Ki-Zerbo, (membre du Comité international Joseph Ki-Zerbo) aborde dans ce grand entretien divers sujets d’actualité, la Covid-19, le panafricanisme, la mal-gouvernance, l’esclavage, les droits de l’homme, le fédéralisme africain, etc.
Entretien réalisé par Serges David
Avec des panafricains, dont le prix Nobel Wole Soyinka, vous avez lancé un appel aux dirigeants africains. Pourquoi ?
Merci à IC Publications de me donner la parole. Dans ce bout de terre du Plateau des Guyanes qu’est l’ouest guyanais, Saint-Laurent du Maroni, nous avons coutume d’entendre nos parents et amis dirent que nous sommes « loin ». Loin d’eux certes, mais aussi loin des grandes métropoles qui donnent le la de la mondialisation, de la vie internationale.
Eh bien cette année, j’ai entendu plusieurs fois des proches me dirent qu’ils viendraient me voir. Tel est le paradoxe de cette entité plus que minuscule, la Covid-19, qui a fait des dégâts considérables : humains d’abord, économiques ensuite.
En imposant le confinement, surtout dans le monde industrialisé, elle a imposé un affaissement des certitudes déjà remises en question par les appels légitimes d’acteurs progressistes tels que les panafricanistes, les écologistes dont la jeune et sympathique Greta Thunberg, le Pape François…
Le professeur Lazare Ki-Zerbo au Du Bois Center à Accra
Il est donc normal que je réponde à l’appel de cet humaniste qu’est Wole Soyinka, et de certains amis, pour, une fois de plus, nous faire tout simplement l’écho des majorités trop occupées à rechercher de quoi nourrir, soigner, héberger ou vêtir leurs familles. En effet, bien que cela ait pour le moment été démenti le spectre de l’épidémie de la Covid-19 s’emparant de notre cher continent nous donne encore aujourd’hui des cauchemars. Tenez-vous bien : Si des pays développés hyper-équipés ayant 4 à 5 médecins pour 1000 habitants enregistrent quasiment 300 000 morts en un trimestre, quels seraient les effets dans un pays où ce ratio avoisine 0 ?
Vous et vos pairs intellectuels, vous écrivez dans cet appel que : « Le manque de volonté politique et les pratiques extractives des acteurs extérieurs ne peuvent plus servir d’excuse à l’inaction. Nous n’avons plus le choix : Nous avons besoin d’un changement radical de direction ». C’est une vraie injonction avec un changement de ton…
Ma propre interprétation est la suivante. Je viens d’évoquer la tragédie humaine qu’a provoquée l’épidémie. Mais les peuples africains vivent dans un stress permanent à cause des carences extrêmes que les médias afro-pessimistes aiment servir abondamment avec ce label estampillé sur eux (« un des pays les plus pauvres du monde ») comme au temps de l’esclavage : par exemple l’accès à l’eau potable, l’incidence du paludisme, la malnutrition, l’état désastreux des infrastructures, etc.
L’Afrique est présentée comme une encyclopédie de l’échec et il y a malheureusement des faits qui corroborent cette image. Que peut faire un chef d’Etat africain face à ces calamités, en 4 ou 5 ans ? S’il a sous la main un plan de redressement du pays et se dit patriote, il fera la tournée des bailleurs, participera à un Sommet Chine-Afrique, Turquie-Afrique, etc., proposera un Code minier avantageux…Jusqu’à quand cette course vers un horizon qui recule au fur et à mesure ? Il faut changer de cadence et viser des leviers structurels tels que la taille critique et la protection de l’espace économique (régional et continental), l’utilisation des langues nationales, la valorisation des savoirs endogènes. Autrement dit une vraie souveraineté, qui n’est envisageable que dans le cadre d’une fédération des Etats actuels.
Cette interpellation des gouvernants africains répond-t-elle vraiment à une urgence actuelle au regard de la situation de la Covid-19 dans les différents pays africains, ou est-ce juste un simple effet de mode ?
Il serait imprudent de pronostiquer que l’Afrique va échapper à cette épidémie. Mais pour le moment, on peut dire au moins deux choses. Premièrement, les gens saluent la capacité de pays comme l’Ethiopie ou Madagascar à mobiliser leurs ressources logistiques et industrielle au service de leurs concitoyens et de l’Afrique.
De même le médicament Apivirine suscite beaucoup d’espoir au Burkina Faso, malgré quelques problèmes de communication. C’est dire que, et c’est le deuxième point, l’épidémie survient dans un contexte de vigilance accrue des intellectuels et des citoyens. Les gens ne veulent plus de l’aventurisme politique et souhaitent que des ruptures interviennent. Peut-être parce que l’insécurité est beaucoup plus palpable, et par conséquent une certaine défiance vis-à-vis des Etats s’exprime, et en même temps une demande de changement positif.
Vous appelez à une « nécessité de gouverner avec compassion » dans la gestion de la Covid-19. N’êtes-vous pas en train de fortifier ces populations africaines qui pensent que la Covid-19 est une « maladie de Blancs ».
A cause de la formule un peu « vieux jeu » ? Sinon ce serait une injure à la mémoire de Manu Dibango, Aurlus Mabélé et tous ces Africains emportés par le coronavirus…
Gouverner avec compassion, c’est abandonner la vulgarité, la cruauté même, de certains comportements prédateurs et destructeurs. Les scandales en la matière sont peut-être moins spectaculaires qu’au temps d’un « Mobutu roi du Zaïre » par exemple, mais ils existent. Quand des milliards sont détournés, quand des hôpitaux publics deviennent des repères du vol et du trafic des téléphones portable apportés par les patients, etc., on peut dire que la compassion est bien loin.
De façon structurelle, l’exportation frauduleuse des ressources naturelles alors que les pays sont étranglés par le remboursement de dettes est aussi incompréhensible pour toute personne ayant un minimum d’intégrité. Il ne s’agit donc pas d’une maladie de Blancs ou même d’une maladie tout court, il s’agit d’un mal politique, d’une culture politique parfois morbide, même si son ancrage recule. Les dirigeants d’un pays comme la Tanzanie forcent l’admiration.
Je voudrais enfin ajouter que le discours de la haine contre l’ennemi, Blanc, Chinois, l’Autre, ne nous avance pas. On recherche des solutions, et la cohésion, l’union sacrée pour des causes justes, en fait partie. Il y a de véritables délires de persécution ou des formes d’hystérie vengeresse qui ne reflètent pas les valeurs humanistes profondes que l’Afrique a su inventer. Ces pathologies, des « passions tristes », dirait Spinoza, traduisent plutôt un sentiment d’impuissance, qui lui est compréhensible.
Sur justement cette pandémie, plusieurs thèses complotistes et souvent conspirationnistes inondent le débat public. Pensez-vous, vous aussi, que dans un endroit caché, des puissants de ce monde se sont réunis pour « fabriquer » ce virus afin d’éliminer les populations singulièrement les Africains ?
Justement, c’est ce à quoi je fais allusion. Mettons-nous d’accord : Il y a bel et bien eu des violations des normes de bioéthique formulées, par exemple, dans les Principes d’Helsinki sur la recherche médicale (1964). J’ai reçu un long témoignage d’une infirmière retraitée, dans lequel elle évoque l’utilisation des prostituées de Nairobi, dans les essais pour découvrir un vaccin contre le SIDA. Ce cas est avéré et il y en a beaucoup d’autres. La vigilance est donc de mise, car les faits existent.
Toutefois, les réseaux sociaux ont été inondés d’informations si fantaisistes, qu’on devrait passer plus de temps à rechercher des sources plus crédibles pour éliminer les Fake News. Une spirale sans fin qui nous mène dans l’univers de la post-vérité, un univers où il y a beaucoup d’ombres et de fantômes inquiétants, comme le fascisme, la propagande totalitaire.
Les intellectuels et tous les patriotes doivent combattre ce fléau, et s’engager dans une action constructive, éducative qui procure de la joie, de la liberté. Et nous éloigne de ce labyrinthe de rumeurs et de satisfactions dérisoires où la négativité l’emporte.
Il faut s’intéresser aux solutions et aux processus qui transforment positivement la réalité. Imaginaire ? Chiche ! Mais un imaginaire de production d’alternatives, de mutualisation, de transformation des savoirs endogènes.
La colère peut être un ferment révolutionnaire quand elle n’est pas que ressentiment de frustré ou de traumatisé. L’amour aussi.
Le travail fondamental de Fanon porte sur le traumatisme de l’humiliation, dont les séquelles sont vivaces, notamment dans cette volonté de diaboliser pour trouver un bouc-émissaire.
En 2017, vous avez publié L’idéal panafricain contemporain ; qui est une ode au panafricanisme. Trois ans après, quel bilan sur le panafricanisme en faites-vous ? Avez-vous atteint le but que vous visez avec cet ouvrage ?
Merci de le rappeler. Cet ouvrage collectif tourne autour de l’héritage de la Conférence panafricaine des peuples tenue à Accra en 1958, et dont nous avions commémoré le Cinquantenaire à Ouagadougou en décembre 2008. Nous voulions contribuer à décloisonner les histoires de l’Afrique, car elles respectent les barrières linguistiques héritées de la colonisation. Je n’ai pas de statistiques, mais je note la mobilisation autour de la question de la souveraineté monétaire, et la manière dont les réseaux sociaux témoignent d’un regain d’intérêt de la jeunesse pour le panafricanisme.
Nous avons en tout cas produit un document de référence qui peut permettre aux lecteurs francophones de mieux connaître ce moment important dans la longue gestation du mouvement panafricaniste.
Le panafricanisme est présent dans bien des démarches, depuis la revendication des cheveux naturels que dans les expressions littéraires ou cinématographiques (Black Panther) de l’Afrofuturisme… La bataille contre le Franc CFA est un autre exemple.
Il est un reproche fait aux panafricains qui est récurrent. Que répondez-vous donc à ces critiques qui perçoivent le combat pour le panafricanisme comme une vue de l’esprit et un hymne au repli identitaire ?
L’ensemble du continent s’est doté de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Faut-il croire que c’est une simple lubie ? En réalité, la menace d’effondrement des Etats sahéliens indique bien que Kwame N’Krumah avait raison, par exemple, en ce qui concerne la défense commune. Les frontières ont toujours été poreuses dans la Boucle du Niger et penser aujourd’hui que des armées nationales juxtaposées peuvent l’emporter, face à un ennemi volatile et transnational, est absurde.
Il faut améliorer simplement les cadres de formulation d’un Agenda panafricaniste moins institutionnel, celui des citoyens mobilisés dans une campagne pour un abandon de souveraineté à la future fédération. Pour moi, l’avenir du panafricanisme, c’est le fédéralisme. Autrement dit, dépasser une conscience essentiellement historique, pour l’enraciner dans la géographie des territoires : Les villes, les agglomérations, les pôles urbains et régionaux, les collectivités territoriales.
Peut-on persister avec vous à penser ou à présenter le panafricanisme comme un positionnement et une résistance face aux forces impérialistes qui soumettent leur projet à l’Afrique ou qui la soumettent tout court ?
L’idée est simple : L’union fait la force. Nos 54 Etats mettront des siècles à aller poussivement vers des résultats médiocres. La fédération doit changer en profondeur le métabolisme de nos sociétés. Aujourd’hui les pays africains ne pèsent guère et ils sont le jouet des grandes forces économiques, de la « communauté internationale », une communauté d’intérêts née avec le monde d’après 1945, avec les institutions de Bretton Woods et l’ONU.
Un gouvernement continental représentant un milliard d’Africains, et des ressources immenses, devrait avoir les moyens de sa souveraineté, à condition bien sûr d’accompagner la naissance de la fédération d’un programme efficace de transformations multiformes : Juridique, administratif, économique, etc.
Le rôle de l’expertise africaine expatriée sera très important. La mobilisation sans équivoque des jeunes panafricanistes a eu des conséquences sur la position de la Cedeao par rapport à la monnaie par exemple. Il faut accélérer et multiplier les processus de ce genre à travers une mobilisation mieux organisée des citoyens.
En plus d’être géographique et d’être une idéologie, le panafricanisme ne gagnerait-il pas aussi à être un concept socio-économique ?
Le panafricanisme a plusieurs dimensions. Il s’est transformé selon les époques. Pour N’Krumah, il fallait appuyer sur le levier politique d’abord et tout le reste en découlerait. Il n’a pas été suivi. Après des décennies de politiques d’intégration économique sans impact structurel sur l’extraversion des systèmes d’échange et de production, il faut convenir que la pierre angulaire du changement c’est l’existence d’un espace politique continental unifié doté d’une vision claire de notre 21è siècle.
Soixante ans après « All African Peoples Conference » de 1958, le constat est que le chemin du panafricanisme a quasiment du mal à se baliser. La nouvelle génération africaine ne le connaît presque pas. N’y a-t-il pas un travail à faire de ce côté ?
Je crois que vous vous trompez. J’ai échangé récemment avec des jeunes de l’Alliance patriotique panafricaine (APP) – Burkindi au Burkina Faso, et j’ai été agréablement surpris de voir combien leur connaissance du mouvement panafricaniste était approfondie. Dans tous les cas, il ne s’agit pas de se contenter d’une connaissance livresque. Il faut effectivement re-enraciner le mouvement et il y a des initiatives en ce sens. Les différents indices que j’ai mentionnés précédemment vont coaliser et la réalité supranationale va s’imposer. Le désir de centaines de millions de personnes est une force irrésistible.
Pouvez-vous expliquer à cette jeunesse ce qu’a été Le Maafa (holocauste d’asservissement du peuple africain), et quel a été son rôle dans la prise de conscience du panafricanisme de combat ?
C’est une question importante et colossale, vous me permettrez de citer Joseph Inikori, qui traite du sujet dans le cinquième volume de l’Histoire générale de l’Afrique, reste notre référence. Elle est accessible en ligne gratuitement.
Selon lui « du point de vue de l’histoire mondiale, le commerce d’exportation d’esclaves originaires d’Afrique, en particulier la traite transatlantique, est un phénomène unique à plusieurs égards. Son ampleur même, son étendue géographique et son régime économique – en matière d’offre, d’emploi des esclaves et du négoce des biens qu’ils avaient produits – sont autant de traits qui distinguent la traite des esclaves africains de toutes les autres formes de commerce d’esclaves. (…), globalement, ce sont environ 22 millions d’individus qui ont été exportés d’Afrique noire vers le reste du monde entre 1500 et 1890 ».
On pourra aussi découvrir le célèbre témoignage de Olaudah Equiano enlevé au Nigeria à la fin du 18è siècle. En lisant le récit historique de V. Naipaul, La Perte de l’Eldorado, on touche du doigt la cruauté indicible du terrorisme esclavagiste. Il faut lire aussi Le Code noir français par exemple pour comprendre et savoir.
Maafa c’est la dislocation durable des sociétés et des familles africaines, avec un effondrement des institutions et de l’équilibre mental des humains, aussi bien les personnes mises en esclavage que les auteurs et bénéficiaires de ce crime contre l’Humanité. On peut citer comme conséquence le sous-peuplement de l’Afrique, compte tenu de sa superficie ; la polarisation Nord-Sud, encore visible en Afrique de l’Ouest : Elle reflète le rôle des côtes du Golfe de Guinée et de l’Atlantique de manière générale comme point de départ des navires négriers.
Le traumatisme mental affecte la vie psychique et sociale des Africains et des Afro-descendants, les jeunes adultes passant, de l’enfermement de la Plantation à l’univers carcéral actuel, notamment aux Etats-Unis. Angela Davis a bien étudié ces questions. L’enfermement identitaire et le déni de soi sont aussi le revers d’une même médaille.
Les panafricanistes semblent se satisfaire de la situation actuelle des droits de l’homme en Afrique. Or précisément dans plusieurs pays de ce continent les droits des populations sont constamment violés. N’est-ce pas là étrange ce silence quasi-complice des panafricains ?
Vous avez raison de douter, mais ce n’est pas exact. Le panafricanisme est l’une des formes les plus anciennes de revendication des droits humains, non seulement en Afrique, mais dans le monde. La culture des droits humains dans le contexte des peuples africains c’est le panafricanisme. En août 2020, ce sera le centenaire de la Déclaration des droits des peuples nègres adoptée par l’UNIA, l’organisation de Marcus Garvey.
C’est le lieu de déplorer ici la disparition de ce cadre continental de mobilisation qu’était l’Union interafricaine des droits humains (UIDH), présidée par Halidou Ouédraogo, avec son siège à Ouagadougou.
On peut plutôt dire que l’absence d’organisation panafricaniste de masse fait que le discours des droits humains, surtout dans l’Afrique francophone, est pris en charge par des organisations qui ne s’appuient le plus souvent que sur la tradition juridique individualiste européenne, et non sur l’histoire des luttes d’émancipation évoquées ici. Le panafricanisme c’est aussi le droit au développement, le droit à la souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles, le droit de parler sa propre langue et d’exprimer sa propre identité culturelle, le droit à l’eau.